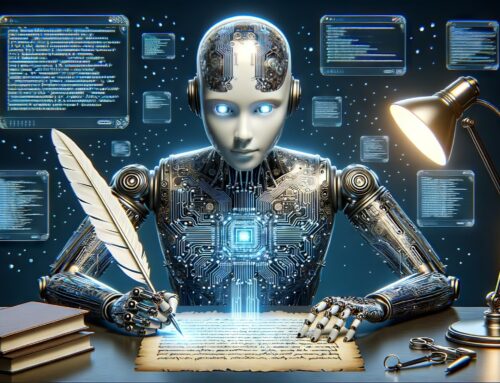Il est fréquent qu’un informaticien collabore avec un professionnel spécialiste de son métier. Ils élaborent ensemble un logiciel. Sans le savoir-faire du professionnel, l’informaticien ne pourrait pas faire grand chose. Réciproquement, le professionnel ne sait pas coder. Les deux ont donc intérêt à travailler ensemble.
Il peut y avoir un contrat entre les deux, mais pas toujours. Et quand il existe, il est souvent imparfait. Pourquoi ? peut-être parce qu’au début, la relation démarre en confiance, qu’il s’agit « juste » de réaliser un prototype, puis que les personnes sous-estiment l’importance du droit, parce que, n’est-ce pas, l’avocat, ce n’est pas utile et ça coûte cher…
Enfin, ça coûte surtout cher après. Quand on n’a pas investi et qu’on se retrouve à gérer une situation inextricable.
Il y a deux décisions rendues par la cour d’appel de Paris, à quelques années d’intervalle, qui ont été rendues dans des affaires très similaires : un médecin collabore avec un informaticien. Tout se passe bien pendant quelques mois. Puis l’affaire tourne au conflit.
Dans la première affaire, tranchée dans un arrêt du 10 novembre 2010, la cour d’appel a arbitré en faveur de l’informaticien. Elle indique que : « les informations et observations manuscrites énoncées soit sur des feuilles volantes soit sur des imprimés … dans le cadre de l’échange de questions-réponses institué entre l’informaticien et le médecin dans la phase d’élaboration du logiciel, procèdent … de l’expérience du praticien et ne sauraient être regardées comme formalisant une logique de programmation informatique mais tout au plus comme regroupant les idées et principes émis par l’utilisateur à l’intention de l’informaticien appelé à les mettre en œuvre dans le programme à réaliser ». Le médecin n’est pas l’auteur du logiciel. C’est une solution très orthodoxe : celui qui code est le propriétaire du logiciel.
Dans la deuxième affaire, la solution atteinte est inverse : le médecin est reconnu comme co-propriétaire. Avant le conflit, l’informaticien et le médecin avaient constitué une société ensemble. La cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 28 mai 2013 avait soigneusement analysé les apports de chacun, et les contrats conclus (notamment les statuts de la société constituée ensemble). Elle avait retenu que le logiciel en cause avait été vendu plusieurs mois par la société commune. Elle avait donc déduit que la société était titulaire des droits d’auteur sur le logiciel.
La cour de cassation a cassé la décision par un arrêt du 15 janvier 2015, en critiquant surtout la rédaction de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes. J’avais commenté cet arrêt de 2015.
L’affaire a été renvoyée à la cour d’appel de Paris qui est parvenue exactement à la même solution que la cour d’appel de Rennes ! Dans un arrêt du 17 mai 2016, elle a attribué les droits d’auteur sur le logiciel à la société… mais en passant par une petite finesse juridique. En informatique, on appelle cela une solution de contournement.
La cour d’appel de Paris a dit que le logiciel était une œuvre collective, qui appartient à la société qui prend l’initiative de la conception du logiciel.
C’était une acrobatie juridique, ce qu’on appelle en droit une filière inversée : la cour d’appel a voulu que la société soit titulaire des droits. Comme la cour de cassation lui avait interdit de dire que la société était la créatrice du logiciel, elle a commencé par dire que logiciel était une œuvre collective.
L’œuvre collective est définie à l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle.
Dans une œuvre collective, c’est la société qui est titulaire des droits sur l’œuvre. Mais il faut pour cela qu’il y ait fusion des contributions, en bref, qu’on ne sache plus dire quelle personne a fait quoi précisément. La cour d’appel a donc affirmé qu’il y avait fusion des contributions de l’informaticien et du médecin.
C’est très audacieux, car un informaticien qui code et un médecin, même spécialiste mondial de son domaine, apportent des choses différentes dans la création du logiciel.
Peu importe : seul comptait le résultat pour la cour d’appel de Paris.
Entre-temps, l’un des acteurs était économiquement mort (en liquidation judiciaire), et l’équité, vue par les deux cours d’appel, était respectée.
Quelles leçons tirer de ces affaires ?
D’abord, un bon contrat est toujours préférable.
Ensuite, une juridiction peut tordre (un peu) les principes du droit d’auteur quand elle veut atteindre une solution qui lui paraît équitable.
Enfin, aujourd’hui, il y aurait sûrement une discussion ravivée car les idées à la base d’un logiciel peuvent être protégées par le secret d’affaires prévu par l’article L 151-1 du code de commerce. Mais la loi existe depuis l’été 2018, il n’y a pas encore de jurisprudence sur ce sujet.
La date de publication de cet article est : 09/03/2021 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.