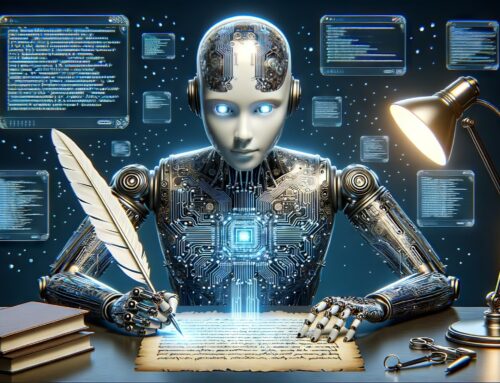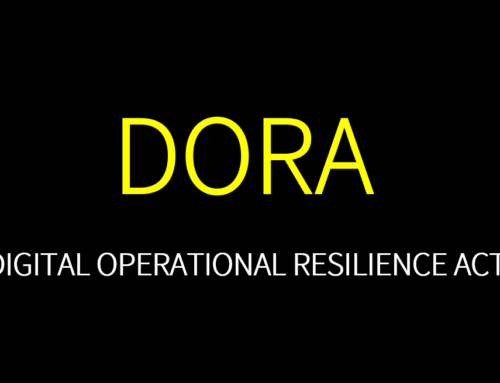La cour d’appel de Poitiers valide le contrat : ni dol, ni manquement à l’obligation de conseil.
L’intégration d’un progiciel dans un projet important entraîne des coûts importants et peut donner lieu à des réclamations encore plus fortes. Lors de l’attribution d’un tel projet d’intégration (souvent dans le cas d’un appel d’offres plus ou moins formalisé), la tentation est grande pour les candidats de proposer des devis à des coûts très serrés dans des délais brefs afin de satisfaire une clientèle très exigeante et d’emporter le marché.
A tel point que ces devis s’avèrent parfois irréalisables en pratique. Les véritables modalités de la prestation sont affinées après signature, et le prestataire présente un certain nombre d’avenants qu’il doit faire accepter au client.
Le client se trouve parfois dans une situation proche de l’otage (accepter la plus-value) après avoir tenté de pousser ses avantages au cours de la phase de négociation pré-contractuelle.
Classiquement, le prestataire prend bien soin d’intégrer au contrat une clause limitant sa responsabilité et le client s’accroche à son sacro-saint forfait.
Dans un tel contexte (avec cette précision qu’il ne semble pas y avoir eu d’appel d’offres préalable), la MAIF avait contracté avec IBM pour intégrer un logiciel (manifestement lourd) de CRM (gestion de la relation client). Les relations se sont envenimées : après expertise judiciaire, le TGI de Niort, saisi par IBM, avait annulé le contrat pour dol et condamné IBM à payer à la MAIF 11 millions d’€ (14 décembre 2009).
La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 25 novembre 2011, renverse complètement cette décision : elle valide le contrat, et condamne la MAIF à payer plus de 4 millions d’€ à IBM au titre des prestations réalisées.
En détail, la MAIF avait acquis en 2002 une licence de progiciel auprès de son éditeur, la société SIEBEL. Ce logiciel, baptisé « GRS » était destiné à la modernisation et à l’optimisation de la relation de la MAIF avec ses sociétaires. L’éditeur SIEBEL n’est pas parvenu à intégrer le progiciel dans le système informatique de la MAIF. La MAIF a donc recherché un intégrateur et après une phase d’études préalables, en novembre 2004, la MAIF a conclu avec IBM un contrat portant sur l’intégration du progiciel GRS.
Il s’agissait d’un contrat « clés en main » dans lequel IBM s’engageait à opérer l’intégration du progiciel dans un délai impératif et à un coût défini. Le contrat était assorti d’une clause limitative de responsabilité en faveur d’IBM.
Au fur et à mesure des travaux, les parties ont signé plusieurs avenants au contrat initial décalant le calendrier et réévaluant le coût du projet.
En juin 2006, la MAIF a mis un terme au projet GRS, puis a assigné IBM en expertise. Parallèlement, IBM a assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de Niort pour obtenir le paiement de ses prestations (plus de 7 millions d’€), tandis que la MAIF réclamait plus de 18 millions d’€ de dommages-intérêts.
En première instance, le TGI de Niort a prononcé l’annulation du contrat et des avenants pour dol, en retenant qu’IBM avait surpris le consentement de la MAIF en lui faisant croire que le projet était susceptible d’être réussi dans les conditions initiales. Le TGI a relevé qu’IBM savait parfaitement, et ce depuis le début, que les termes du contrat étaient irréalistes. Le tribunal avait condamné IBM à verser à la MAIF la somme de 11 millions d’euros de dommages et intérêts. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire.
La société IBM a interjeté appel de cette décision. Pour obtenir la réformation du jugement, IBM a soutenu que la MAIF avait connaissance des difficultés et des risques associés au projet puisque le projet avait été ajusté par des avenants successifs acceptés par la MAIF en toute connaissance de cause.
Enfin, IBM a avancé qu’elle ne pouvait avoir manqué à son devoir de conseil compte tenu de la parfaite connaissance technique du projet par la MAIF.
Le problème pratique posé par cette décision est le suivant : dans des cas similaires, le client doit-il/peut-il adopter une attitude réaliste (voire bienveillante) à l’égard de son prestataire au risque de se voir plus tard reprocher sa mansuétude ou doit-il se montrer intransigeant dès que le prestataire réclame une plus-value sur le budget initial et/ou un décalage de calendrier ?
Le 25 novembre 2011, la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par IBM, a infirmé le jugement du TGI de Niort et fait droit aux autres prétentions de la société IBM. La cour a condamné la MAIF à verser à IBM la somme de 5 millions d’euros.
La cour d’appel de Poitiers n’a pas retenu le dol, ce qui peut être discuté (I). Elle a rejeté toute critique sur l’obligation de conseil à la charge du prestataire, en s’appuyant sur le caractère variable de l’obligation, reconnaissant à la MAIF la qualité de client non-profane (II).
I. Le refus du dol par la cour d’appel
La solution retenue par la cour d’appel de Poitiers (A) est discutable, tant sur le plan juridique que pratique (B).
A. La solution retenue par la cour.
Tout d’abord, IBM opposait une fin de non-recevoir à la MAIF : dès que la MAIF avait unilatéralement résilié le contrat d’intégration, elle aurait renoncé à demander la nullité pour dol. La cour écarte ce moyen. Cet aspect de la décision ne recèle que peu d’intérêt.
La solution retenue par la cour sur le second moyen, relatif au dol, est beaucoup plus intéressante.
En première instance, le TGI de Niort avait relevé qu’IBM avait présenté un devis irréalisable selon le calendrier et le budget prévu, et que le prestataire le savait depuis le début, ce qui constituait les « manœuvres frauduleuses » de l’article 1116 du code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. »
Selon le tribunal, la société IBM avait gardé le silence sur des éléments qui, s’ils avaient été connus du maître de l’ouvrage, l’auraient empêché de contracter. Partant, le silence gardé sur les risques encourus et la minimisation du prix étaient de nature à vicier le consentement de la MAIF. En conséquence, le TGI de Niort a retenu le dol et annulé le contrat.
Le prononcé de la nullité du contrat entraînait deux conséquences juridiques et leur pendant financier :
- la disparation du contrat,
- et donc la restitution des acomptes perçus par le prestataire,
- l’inefficacité de la clause limitative de responsabilité,
- de sorte que le tribunal avait pu allouer des dommages et intérêts à hauteur de l’entier préjudice subi, selon le tribunal, par la MAIF, soit plus de 11 millions d’euros.
La cour d’appel de Poitiers opère un revirement complet. Elle infirme le jugement du tribunal de grande instance de Niort sur le dol invoqué par la MAIF ainsi que sur les fautes prétendument commises par IBM.
La cour d’appel de Poitiers accumule plusieurs motifs de refus de l’argumentaire de la MAIF :
- En premier lieu, la MAIF avait pleine connaissance des difficultés et risques associés, car elle disposait de la compétence technique de son service informatique et de la connaissance des difficultés spécifiques liées à l’implantation du logiciel en cause. En effet, la société SIEBEL avait précédemment échoué à intégrer le logiciel GRS dans le système d’information de la MAIF.
- Deuxièmement, la MAIF ne peut au stade de la conclusion du contrat se prévaloir d’un dol par réticence concernant le risque de retard alors même que « la sanction d’un tel retard avait été prévue » au contrat initial. Qui plus est, selon la cour, « la Maif ne démontre pas le caractère déterminant de son consentement des délais de réalisation. »
- Dans un troisième temps, la cour insiste beaucoup sur le fait que la MAIF a accepté les avenants décalant la progression et l’échéance de l’intégration en connaissance de cause. La redéfinition des charges et du planning, donc du projet initial en connaissance du vice qui l’affectait à l’origine emporte, selon la cour, renonciation à se prévaloir de la possibilité d’en contester la validité.
- Si ce n’était pas suffisant, la cour relève que la MAIF a également sa part de responsabilité dans l’échec du projet. Ces dysfonctionnements étaient notamment imputables « au fort cloisonnement, au manque de collaboration, de solidarité entre les différentes équipes MAIF, voire à l’esprit de corps incompatible avec le travail d’équipe ».
Sur ces quatre fondements, la cour d’appel de Poitiers écarte la réticence dolosive invoquée par la MAIF.
La solution retenue concernant le dol ou plutôt l’absence de dol, aussi imparable qu’elle semble de prime abord, donne pourtant matière à débat.
B. Critique de la solution.
Tout d’abord, la première remarque venant à l’esprit est que la cour a pris soin de multiplier les arguments pour justifier sa solution. On se doute bien que, compte tenu des intérêts en jeu, le pourvoi est probable (il l’aurait été tout autant en cas de solution inverse).
Classiquement[1], pour être retenu comme cause de nullité d’une convention, le dol :
- est constitué par des manœuvres, un mensonge ou un silence,
- doit avoir causé une erreur déterminante du consentement des parties,
- être prouvé (il ne se présume pas),
- et il se distingue du « bon dol », l’exagération, l’hyperbole commerciale.
En matière informatique, on trouve un très bon exemple en jurisprudence d’un dol qui entraîne la nullité d’un contrat : un vendeur de logiciel avait affirmé qu’il était seul titulaire de tous les droits d’auteur sur le logiciel vendu, alors que le logiciel avait été écrit avec deux co-auteurs (Cass. 1ère civ. 13 Décembre 2005, 03-14.003).
Selon la MAIF, les conditions étaient réunies pour un dol : IBM lui aurait masqué son incapacité à tenir les délais et les budgets, l’expertise démontrait qu’IBM savait depuis le début ne pas pouvoir tenir ses engagements et enfin la MAIF aurait fait du respect des délais et des budgets une cause déterminante de son consentement.
Dans le contrat initial, la MAIF avait intégré une obligation de résultat sur deux points : le budget et les délais.
La cour d’appel de Poitiers affirme pourtant que « la MAIF ne démontre pas le caractère déterminant de son consentement des délais de réalisation ». Cette assertion est étonnante. En effet, lorsqu’une des parties introduit au contrat une obligation de résultat, c’est, a priori, qu’elle accorde à cet aspect une importance déterminante. Selon la cour d’appel, cela ne suffit pourtant pas à justifier du caractère déterminant de l’obligation.
Comment alors, en pratique, s’assurer dans un contrat du caractère déterminant du consentement pour une obligation ? La solution consisterait sans doute à introduire des clauses spécifiquement mises en valeur dans le contrat et assorties d’une mention explicite « clause déterminante du consentement » pour éviter toute interprétation ou équivoque par la suite.
Par ailleurs, la cour d’appel retient que le fait d’avoir accepté des avenants au contrat initial emporte renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat initial. La formulation de la cour d’appel est d’ailleurs sans équivoque : « En redéfinissant le projet en connaissance du vice initial, qui affectait le contrat le 14 décembre 2004, et afin de le réparer, la MAIF a nécessairement renoncé à se prévaloir de la possibilité d’en contester l’efficacité ».
La cour d’appel s’appuie sur le fait que le dol est sanctionné par une nullité relative. Or, à l’opposé de la nullité absolue, la nullité relative laisse la possibilité de confirmer le contrat nul. La cour d’appel interprète le fait de n’avoir pas dénoncé le contrat immédiatement mais au contraire d’avoir tenté de « réparer » le projet comme une renonciation implicite à se prévaloir de la nullité du contrat.
La MAIF aurait donc pêché par excès de bienveillance. La bonne volonté mise à réparer les erreurs du passé lui a été fatale.
Le client aurait donc renoncé à se prévaloir du dol. Quant à sa tentative sur le terrain de l’obligation de conseil, elle est aussi écartée.
II. L’obligation de conseil remplie par le prestataire.
Comme il est classique en la matière, la cour prend en compte la compétence du client pour évaluer l’étendue de l’obligation de conseil et en tire pour conséquence que la responsabilité du prestataire n’est pas engagée à ce titre (A). La solution est critiquable au regard de la dernière jurisprudence en la matière (B).
A. La classique prise en compte de la compétence du client dans l’étendue de l’obligation de conseil
L’obligation de conseil se décompose, selon la doctrine la plus autorisée[2], en trois catégories : l’obligation de renseignement, de mise en garde et de conseil au sens strict.
Quel que soit la catégorie précise invoquée, l’obligation de conseil est une obligation de moyens dans son étendue, mais elle est de résultat quant à la fourniture matérielle du renseignement.
Selon la jurisprudence la plus récente, la démonstration de son exécution ne peut se faire que par écrit (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 75 : « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation »), à propos du médecin, solution reprise pour le notaire (Cass. 1re civ., 7 nov. 2000 : Bull. civ. 2000, I, n° 282). En matière de contrat informatique d’intégration, on cherchera souvent la preuve de l’exécution de cette obligation dans les comités de pilotage…
Cette obligation est d’ordre public, dans le sens où elle s’impose dans les contrats notamment de prestations de service, même si le contrat ne le prévoit pas. Il faut d’ailleurs souligner qu’elle est aussi impérative dans le sens où il semble qu’un contrat ne pourrait pas l’écarter.
Tout au plus, le rédacteur d’un contrat peut-il faire prévoir une clause de « pleine information » par laquelle le stipulant admet qu’il a été pleinement informée. Il ne s’agit pas alors d’écarter l’obligation (en prévoyant qu’elle n’est pas applicable) : la pratique parle par erreur de « décharge de responsabilité ». Il s’agit plutôt d’écrire que l’obligation a été remplie. L’efficacité de ces clauses est toujours douteuse (voir pour un cas d’inefficacité en matière de conseil du notaire- Cass. 1re civ., 26 févr. 1991 : Bull. civ. 1991, I, n° 79).
En matière informatique, l’obligation de conseil a depuis longtemps été retenue à la charge du fournisseur et du prestataire : ainsi, la Cour de Cassation a retenu un manquement à l’obligation de conseil de la part d’un fournisseur qui a livré du matériel informatique incompatible avec le logiciel de traitement de texte utilisé dans l’entreprise (Cass. 1re civ. 3 Avril 2002, 00-12.508).
Enfin, classiquement, on retient que le client qui est compétent en informatique n’est pas créancier d’une obligation de conseil.
En l’espèce, la cour d’appel de Poitiers applique cette solution : elle considère que l’obligation de conseil de la société IBM est relative vis à vis de la MAIF dans la mesure où la MAIF dispose en interne d’un service informatique et que « c’est en connaissance de cause que la MAIF (qui dispose d’une direction informatique étoffée) et ne peut donc être qualifiée de profane dans le domaine informatique… ».
B. La critique de la solution classique : l’impact de la présence d’un service informatique important
Si la solution retenue par la cour d’appel est classique en n’imposant pas au prestataire une obligation de conseil à l’égard d’un client qui n’est pas un profane, il n’est pas en phase avec le dernier état de la jurisprudence. Peut-être la cour d’appel a-t-elle été influencée par le contenu du rapport d’expertise et au final, a-t-elle tranché sur des considérations plus proches de l’équité.
Tout d’abord, la dernière évolution de la jurisprudence est marquée par une grande sévérité à l’égard des prestataires. Jusqu’à récemment, il était admis que l’obligation de conseil bénéficiait d’abord au profane (le particulier, le professionnel d’une autre spécialité) et qu’en conséquence, le professionnel de la même spécialité ne pouvait s’en prévaloir. On pouvait déjà distinguer une vision assez défavorable au prestataire dans certains arrêts lorsque le prestataire était confronté à un client doté d’un service informatique important (voir par ex. Cass. Comm. 6 Mai 2003, concernant – déjà – une mutuelle cherchant à modifier son logiciel principal).
L’évolution ultime est peut-être à trouver dans un arrêt récent de la cour de cassation (Cass. Comm. 7 septembre 2010, 08-17.890) : l’obligation de conseil pèse sur le vendeur professionnel, même à l’égard d’un client de la même spécialité ! Il s’agissait de l’installation d’un système téléphonique et d’appel-malade par une mutuelle (décidément…) à une société spécialiste des systèmes téléphoniques. La société informatique avait acheté le matériel à une autre informatique société. L’arrêt n’est pas très explicite, mais le pourvoi (qui a été rejeté) l’éclaire : « qu’il est de principe que l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné, n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ». En rejetant le pourvoi, la cour de cassation semble étendre encore le domaine de l’obligation de conseil.
Si l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers paraît juridiquement critiquable, la solution a peut-être été dictée par l’appréciation par la cour du miroir pendant de l’obligation de conseil. En effet, l’obligation de conseil est contrebalancée par l’obligation de coopération qui pèse sur le client. Selon la cour, se basant sur le rapport d’expertise, cette obligation n’a pas été remplie par la MAIF : la cour relève que certains dysfonctionnements étaient imputables à la MAIF notamment « au fort cloisonnement, au manque de collaboration, de solidarité entre les différentes équipes MAIF, voire à l’esprit de corps incompatible avec le travail d’équipe ».
Et la MAIF ne peut donc rien espérer sur l’obligation de conseil.
En conclusion, il est difficile de déterminer si le prestataire informatique, en l’espèce, a dépassé l’hyperbole commerciale au moment de la signature du contrat. Ce qui est certain, c’est que l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers place le professionnel qui accompagne des sociétés clientes dans des grands projets informatique dans un paradoxe très inconfortable. Confronté à des difficultés importantes d’un projet informatique, il tentera de redresser le projet.
En procédant de cette manière, il amènera son client à renoncer implicitement à poursuivre la nullité du contrat d’origine. Il sera à ce moment-là confronté à un choix cornélien : tenter de sauver ce qui peut l’être pour réaliser le projet, même dans une version dégradée, ou se prévaloir immédiatement de la nullité en justice.
Attention : c’est un choix sans retour ! Dès la signature d’un avenant, le client sera présumé avoir renoncé à se prévaloir d’un défaut de constitution du contrat d’origine, à suivre la cour d’appel. Gageons qu’un pourvoi probable apportera d’autres enseignements…
Paradoxalement, la décision de la cour d’appel de Poitiers n’incite donc pas à la conciliation.
[1] Voir notamment Bruno Petit, Sylvie Rouxel, JurisClasseur Civil Code, Art. 1116, fasc. unique. Lamy droit de l’informatique et des réseaux 2011, § 857.
[2] Philippe Le Tourneau, contrats informatiques et électroniques, 6ème éd. 2010, spécialement §§ 0.33, 4.53. et 5.15. Philippe le Tourneau, Matthieu Poumarède, JurisClasseur Civil Code, Art. 1136 à 1145, Fasc. 40. M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information dans les contrats : LGDJ, 1992.
La date de publication de cet article est : 06/03/2012 . Des évolutions de la loi ou de la jurisprudence pouvant intervenir régulièrement, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.